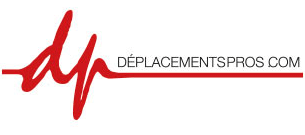Société de commercialisation, puis de distribution et enfin compagnie aérienne, APG fête son 30ème anniversaire. L'occasion de survoler les trois dernières décennies de "la plus petite des multinationales" (sic) et celles de l'aérien avec Sandrine de Saint-Sauveur, sa passionaria de CEO. Entretien long courrier, en une escale et deux segments. Voici le premier, fasten seat belt, ça turbule un peu...
1991, APG voit le jour. A quoi pensez-vous aujourd’hui, quand on évoque cette époque ?
Sandrine de Saint-Sauveur : A des avions ! Des McDonnell Douglas - MD 90 ou DC 10, des 747, encore très présents... Aujourd’hui, quand on parle de ces appareils, c’est comme si on parlait des constellations. C’étaient des avions qui consommaient beaucoup, qui étaient très bruyants - quand vous étiez à l’arrière, près des moteurs, d’un M 82, vous étiez contents... Mais c'étaient des appareils de référence, c'étaient des avions formidables et je m’en souviens avec nostalgie.
C’est aussi L’époque où on commençait à pouvoir voyager plus facilement, où le paysage aérien changeait, notamment en France. AOM, par exemple (née en octobre 1991, de la fusion d'Air Outre Mer et de Minerve, disparue en 2003, ndr) dont nous étions les représentants. On a grandit avec eux...
> A lire aussi : Boeing 747, mort d’un mythe volant
A cette époque, APG s’occupe exclusivement de commercialisation…
 Oui, mais c’était bien différent. On vendait en direct, via des tour operators ou des agences de voyages, ça c’est pareil… Mais c’est une époque où les billets étaient en papier, où les gens aimaient se déplacer dans les bureaux des compagnies aériennes : quand ils dépensaient 5.000 francs pour aller à Papeete, ils aimaient bien voir à qui ils allaient les donner. C’est pour ça qu'on a eu jusqu’à 20 bureaux en France, essentiellement pour AOM mais aussi, en province, pour United, Air Mauritius… Tous ces bureaux ont fermé, ils ne se justifiaient plus avec la numérisation... Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l’année dernière on a rouvert un bureau à Marseille. Nous sommes à la fin d’un cycle, à un moment de réajustement, y compris pour la distribution, dans cette période de crise où les gens ont besoin d’être rassurés.
Oui, mais c’était bien différent. On vendait en direct, via des tour operators ou des agences de voyages, ça c’est pareil… Mais c’est une époque où les billets étaient en papier, où les gens aimaient se déplacer dans les bureaux des compagnies aériennes : quand ils dépensaient 5.000 francs pour aller à Papeete, ils aimaient bien voir à qui ils allaient les donner. C’est pour ça qu'on a eu jusqu’à 20 bureaux en France, essentiellement pour AOM mais aussi, en province, pour United, Air Mauritius… Tous ces bureaux ont fermé, ils ne se justifiaient plus avec la numérisation... Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l’année dernière on a rouvert un bureau à Marseille. Nous sommes à la fin d’un cycle, à un moment de réajustement, y compris pour la distribution, dans cette période de crise où les gens ont besoin d’être rassurés.
Votre marché était alors la France. Quand débute l’internationalisation d’APG ?
Très rapidement. J'intègre APG en 1993 et c’est pour m’occuper de l’international, un peu parce que c’était la patate chaude, que personne ne voulait s’en occuper (rire). Il faut dire que quand on gagnait 3.000 en France, on en gagnait 300 à l’étranger. Mon père (Jean-Louis Baroux, fondateur d’APG, ndr) a eu la conscience que le marché français seul n’intéresserait pas les compagnies. Qu’à partir de ce qu'on faisait bien en France, il nous fallait trouver des partenaires qui le faisaient bien à l’étranger. Ça a été la volonté d’un homme contre tout le monde.
Internationalisation rapide, votre entrée dans la distribution suivra de près.
Au bout de quelques années, en effet. On s’est dit “commercialiser c’est bien, mais il nous faut aussi des réseaux de distribution" et à l'époque, ces réseaux de distribution coûtaient très cher… Pour qu’une compagnie puisse entrer dans un BSP ("Billing and Settlement Plan", la caisse de compensation créée par IATA, qui encaisse les montants des billets d'avion vendus par les agences de voyage et les reverse aux compagnies aériennes membres, ndr) et être vendu à une agence de voyage, ça coûtait 25.000 $.
A la fin des années 90, après des années de rapprochement avec IATA, on a contribué fortement à ce que se développent des réseaux de distribution accessibles aux petites et moyennes compagnies. Alors qu’ils en attendaient quelques dizaines, IATA a été très surprise que 1.500 contrats de distribution nouveaux soient signés… A partir de là, on a pu élargir fortement notre présence à l'international, acquérir une grande compétence concernant la distribution, avec de bons outils valables partout, et aujourd’hui, on a une filiale dédiée, on augmente notre nombre de produits et on se retrouve avec 110 bureaux à travers le monde. A la fin des années 2000, la France est, pour nous, un marché parmi d’autres, au même titre que la Scandinavie ou la Bolivie, par exemple.
Nous sommes au début des années 2000 et vous considérez que cette extension de la distribution est une période charnière...
L’extension du réseau de distribution correspond aussi à sa professionnalisation, capitale pour la confiance et aussi pour répondre à des demandes très précises car les agences de voyage se spécialisent avec, notamment, l’avènement des TMC… Et donc on se parle de pro à pro, il ne s'agit plus uniquement d’éditer un billet. En 2007, l'e-ticketing clôt ce cycle. Pourquoi une telle professionnalisation à ce moment-là ? Parce qu’il y a alors un autre fait, concomitant : la fin des commissions pour les agences de voyage et le passage au service fee. Ça ne s’est pas fait sans heurts : les agences qui n'avaient pas de spécificités sont mortes. Ces défauts d’agences de voyages ont impliqué un problème de sécurisation des fonds pour les transporteurs. C’est pourquoi c’est aussi le début d'une période de grande défiance entre les compagnies aériennes et le réseau de distribution.
Mais aujourd’hui, avec la crise, je crois qu’on arrive à la fin de ce cycle-là aussi : jusqu'alors, la question du défaut des compagnies aériennes, IATA l’a toujours regardée de très loin en oubliant Panam, Sabena ou Swissair (faillites en 1991 pour l’Américaine, en 2001 pour la Belge et la Suisse, ndr), ou bien AOM ou Air Littoral, pour parler de la France. Cette crise va peut-être rééquilibrer les vrais risques du transport aérien, et ils sont des deux côtés : agences et compagnies.
> Lire aussi : Les 12 événements qui ont changé le business travel
Cette période, c’est aussi l’arrivée des low cost…
Quand, à la fin des années 90, EasyJet arrive à Nice, tout le monde regarde ce machin orange avec son numéro de téléphone sur la carlingue avec un dédain profond. Et le refrain des agences de voyages, c'est : “De toute façon, si tu n'es pas dans le GDS, tu n’es pas vendu !”, etc. C’est toujours une erreur de dédaigner. Les compagnies en place ont oublié deux choses : l’humilité et tester le produit.
A l’époque un Paris-Rome, c'était l’équivalent de 600-700 € l’aller-retour journée. Ca ne les valait pas ! Et elles se sont retrouvées à se battre sur des prix avec des coûts incomparablement plus élevés au lieu de se battre sur un produit. Il y a eu parallèlement le développement des hubs pour alimenter le trafic international et c'est sur les "point à point" court courrier qu'on gagnait de l’argent et les low cost ont raflé ce marché-là.
Et celui du long courrier, c’est pour bientôt ?
En tout cas, c’est ce qu’aurait aimé Norwegian… Est-ce que ça a du sens ? Je ne sais pas... Je pense que ce qui a du sens, pour une compagnie, c’est que ses tarifs couvrent ses coûts. Norwegian ne couvrait pas ses coûts. Normalement, une compagnie aérienne est contrôlée tous les mois - c'est le cas de la nôtre - sur ses ratios financiers et surtout, on doit présenter des bilans solides, sans perte de capitaux propres, notamment, sinon on perd notre agrément… Je pense qu'il serait intéressant de savoir combien de compagnies sont aujourd’hui encore dans les clous. Cette crise remet l’église au milieu du village… Le transport aérien a perdu en 2020 ce qu’il a gagné en 20 ans. C’est qu’en 20 ans il y a dû avoir des erreurs… Le cash est brûlé, il arrive et sert à payer les charges du mois d’avant. Si je suis IATA, je dis : “Si vous voulez être distribués correctement, montrez vos bilans. Et si vous perdez de l’argent, mettez des garanties bancaires”. Sauf que personne ne veut faire ça !
Le 2ème segment : "Dans l'aérien, on doit se demander à quel moment on a pété les plombs"