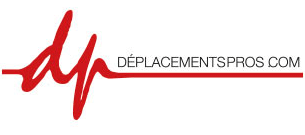L’avion d’Air Caraïbes est plein comme un œuf en ce jeudi 14 janvier. La distanciation sociale ? Un concept. Comme ce fut le cas à Orly au départ quelques jours plus tôt, comme ce fut le cas à Punta Cana (République dominicaine) quelques heures auparavant.
En classe éco, sur cette compagnie comme pour les autres, ce n’est plus de la proximité, davantage de la promiscuité. Les quelque 350 passagers sont masqués, bien sûr, et le personnel à bord y veille attentivement. Sans qu’il soit besoin, notons-le, d’intervenir en ce sens, tant les voyageurs sont respectueux de la consigne.
Mais les masques tombent : on boit un café, un jus de tomate (pourquoi tant de jus de tomate dans les airs vs. le plancher des vaches, la question mérite qu’on s’y penche), on se sustente. On est dans un avion long courrier, soit : un restaurant volant. No comment. Il est vrai que – toutes les analyses vont dans ce sens – les filtres utilisés, le renouvellement de l’air, sa circulation ascendante, sont de sérieux empêcheurs de contaminer en rond pour le virus.
A ce titre, une étude particulièrement vicelarde de Boeing, Airbus et Embraer, a même démontré qu’au pire (et peu ragoûtant) des cas : un passager démasqué qui tousse au côté de son voisin direct, lui aussi démasqué, c’est comme si ça se passait, à l’air libre, à deux mètres distances. Deux mètres de distance, c’est ce rayon qui pourrait être si facilement mis en place par les cinémas et théâtres si on leur en donnait l’occasion. No comment, once again.
N’étant ni restaurateur, ni directeur de théâtre, le spectacle qui m’est donné à voir ne me scandalise pas plus que ça, et le vol se passe agréablement, entre Frères Sisters (c’est du Audiard-fils), Morphée (c’est une divinité grecque) et le dernier magazine de l’Echo touristique (c’est de l’autopromo Eventiz Media Group).
Arrivé à Orly, pourquoi rompre cette intimité qui nous relie tous ensemble à bord depuis une petite dizaine d’heures ? Donc pas de finger : des navettes, pleines comme des huîtres (les journalistes ne doivent pas faire de répétitions). Puis « LE » test Covid à l’aéroport, celui qui scinde le monde en deux : les voyageurs qui arrivent de la belle et pure Europe (qui s’y soustraient de bon droit) et ceux qui émanent de ce bouillon de culture informe, volatile et menaçant : le reste du monde.
C’est un test antigénique. La différence : le temps d’attente du résultat, une dizaine de minutes. Il sera respecté. Pour le reste, c’est le même que l’autre, le vrai, le bon, le PCR : un coton-tige enfoncé en des profondeurs insoupçonnables de chacune de nos deux narines qui nous fait relativiser les récriminations de nos parents quand, enfant, on osait un quart de dernière phalange d’index dans nos trous de nez.
Dix minutes d’attente des résultats seulement, certes, mais dans ce Terminal 4 de l’aéroport du sud-Paris, il a bien fallu que le personnel médical (au demeurant, très agréable et efficace) fasse avec mes quelque 349 co-passagers ainsi qu’avec à peu près le même nombre de clients de Corsair revenus de Côte d’Ivoire une petite demi-heure auparavant.
Après tout ça, on reprend le parcours classique d’un voyageur venant d’une destination extra-européenne : passage de la frontière, récupération des bagages. Très fluide. Sauf que lorsque je commande mon VTC au dépose-minute de l’ancien Orly-Sud, il est 10h du matin. Nous avons atterri 2h30 plus tôt.
Je ne suis ni restaurateur, ni directeur de théâtre, je l’ai dit. Je suis journaliste, et mon domaine, c’est le voyage d’affaires. C’est à cette aune que je me refais le film de cette expérience. Comment les entreprises – notamment les « grands comptes » – vont-elles faire revoyager leurs collaborateurs, obligées qu’elles sont, par leur ô combien justifié duty of care, dans ces conditions ? Je ne sais pas et, donc, je reviens des Caraïbes, laissez-moi prolonger l’indolence ensoleillée de ce séjour : je raconte, je ne réponds pas.