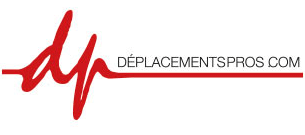La nouvelle compagnie islandaise Play propose désormais un CDG-New York. L'occasion d'interroger CEO sur ses ambitions, le "modèle islandais", le business travel, et l'aérien en général.
Play a été lancée en novembre 2019, un timing peu inspiré !
Birgir Jonsson : C’est une histoire étrange. Play, c’est la réunion de plusieurs personnes venant d’une autre compagnie islandaise, Wow Air. Ils ont effectivement commencé à travailler sur les fondations fin 2019. L’épisode Covid arrive et c’est peut-être pour le meilleur car l'histoire a pris un nouveau tournant en début 2021 quand de nouveaux investisseurs, des institutions et des organisations solides (qui a permis notre entrée au Nasdaq en juin dernier capitalisé à 90 M$), ont maifesté beaucoup d’intérêt pour cette nouvelle compagnie. C'est aussi à ce moment-là, un peu plus tôt, au mois d’avril 2021, que je suis arrivé.
> Lire aussi : Les Nordiques Norse Atlantic et Play offensives sur le transatlantique
Comment fait-on pour donner confiance à des investisseurs quand on a été partie prenante de Wow, une entreprise dans le même secteur, avec un business model similaire, qui a fait faillite ?
J’étais le numéro deux de Wow Air (qui a fait faillite en 2019, ndr) mais c’est déjà assez lointain : j’ai quitté la compagnie en 2016. La proximité des modèles entre Wow et Play est en fait le modèle de la plupart des compagnies islandaises, depuis plusieurs décennies, Icelandair notamment. Le concept est de relier les Etats-Unis à l’Europe via l’Islande. C’est un modèle qui fonctionne très bien. L’erreur de Wow est d'avoir commencé à opérer des avions plus gros sur des distances plus longues : non plus la côte est des Etats-Unis mais Los Angeles… Et à ce moment-là, Wow est sortie de son modèle. Il n’y avait alors qu’un seul propriétaire qui n’avait peut-être pas les fonds pour supporter cette extension.
Ce qui est capital, dans ce modèle, c’est d’optimiser l’utilisation des appareils et des équipages. Donc par exemple, un avion part d’Islande à 4h du matin, il va à Paris, retourne en Islande, puis prolonge jusque Boston et revient en Islande… Si la destination finale est LA, l’avion et le personnel doivent “dormir sur place” car on ne peut pas effectuer une telle rotation en 24 heures. Ce sont donc des coûts supplémentaires.
En créant Play, nous avons donc pris ce qui fonctionne dans ce modèle, et laissé de côté ce qui ne fonctionne pas. C’est comme ça qu’on donne confiance aux investisseurs.
Ce modèle, c’est ce que vous appelez le “hub and spoke” ?
Oui. Il y a un hub central où il y a des vols entrants et sortants - c'est ce qui se passe à Dubaï par exemple. C’est un point de rencontre : les vols entrants alimentent les vols sortants. La force de ce modèle, c'est que si on veut faire un Paris-Boston, via l’Islande, le Paris-Reykjavik n’a besoin d’être rempli - si le vol était direct, j'aurais besoin de 200 ou 300 passagers au départ de Paris. Dans cette configuration, 20 ou 30 passagers sont suffisants car le Reykjavik-Boston sera alimenté par des vols venant d’autres aéroports (20 de Berlin, 20 de Copenhague, 30 de Londres….). Et ça marche aussi au retour bien sûr : tout le monde s’arrête à Reykjavik et y prend l’avion qui correspond à sa destination finale. Donc sur cette route Paris-Boston, je ne suis pas en compétition avec Air France, par exemple, et tant mieux : je n’aurais pas la puissance pour ça - pour remplir des avions de 300 passagers chaque jour : ça me tuerait.
Dans cette connexion entre l’Europe et les États-Unis via l’Islande, quelles routes proposez-vous ?
Nous avons commencé la commercialisation avant Noël des vols pour Boston et Baltimore/Washington qui décolleront entre avril et mai. A partir du 9 juin, une nouvelle destination sera disponible : New York Stewart. Et ces destinations est-américaines sont reliées à une bonne partie des grandes capitales européennes - Paris, Londres, Berlin, Copenhague, Bruxelles, Dublin… Et en supplément, nous avons un réseau de destinations loisirs traditionnelles pour les Islandais : Tenerife, Barcelone… qui sont en dehors de ce système “hub and spoke”.
Vous parlez de destinations loisirs. Qu’en est-il de la clientèle business ?
C’est une question intéressante car elle repose sur la notion de “business traveler”… J’ai toujours eu un problème avec cette définition qui associe cette clientèle à la première classe, au champagne… Pour moi, un business traveler est simplement un voyageur qui ne voyage pas pour des raisons personnelles - il peut participer à un séminaire ou se déplacer pour réparer une machine-outil… Et beaucoup d’entre eux voyagent en classe éco parce que l’argent du billet ne sort pas de leur poche, que c’est la direction de leur entreprise qui décide avec un souci d’économie évident. Dès lors, le système lowcost leur convient parfaitement - d’ailleurs, Ryanair profite à plein de ce type de clientèle.
Et pour la convaincre, j’ajoute que nous sommes attentifs à la fluidité du parcours clients dans les aéroports où nous sommes présents, que le bagage est pris en charge dès l’aéroport de départ, que nos transits à Reykjavik sont de moins de deux heures, que le pitch (l'espacement entre un siège et celui placé devant) vaut celui de nombreuses premium, et que notre système stop-and-go peut même permettre un séjour bleisure de quelques jours en Islande. Donc, bien sûr, le stéréotype du business traveler pour qui compte uniquement la rapidité du voyage, quel qu’en soit le coût, ce n’est pas pour nous. Mais tous les autres (et ils sont nombreux), oui ! En résumé : non, nous n’offrons pas de service business mais oui, nous ciblons aussi la clientèle business.
Vous évoquez Ryanair… C’est une des compagnies qui s’est le mieux sortie de la crise. Quelles leçons en tirez-vous ?
Ce que j’ai appris de Ryanair : il faut se focaliser sur son business model. Je l’ai déjà dit : l’erreur de Wow est de l’avoir outrepassé. Chez Ryanair, ils sont complètement concentrés sur leur business model : “Nous ne ferons jamais de transatlantique, nous n’irons jamais en Amérique, car nous ne voulons pas y avoir du staff, y laisser “dormir” nos avions durant 24 heures... Notre modèle est de faire des vols courts et multiplier les aller-retours comme une compagnie d’autocars”. C’est pourquoi ils sont si forts : faire une seule chose, la faire très bien et ne pas compliquer les choses inutilement. C’est une très bonne leçon pour nous.
Ça signifie que, vous CEO de Play, jamais vos avions ne se retrouveront sur la côte ouest américaine ?
Il ne faut jamais dire jamais. De la même façon, pour modérer ce que je viens de dire, Ryanair sera peut-être aux Etats-Unis dans 20 ans. Mais, pour revenir à Play, si un jour nous le faisons, c’est que nous aurons tout fait avant. Nous voulons rester relativement petits et agiles. Ainsi, quand le contexte est bon, ça va bien, quand il ne l’est pas, on y survit. On ne veut pas traverser une crise avec 100 avions immobilisés au sol !
En conséquence, notre posture est modeste et notre business plan, précis : nous avons trois appareils aujourd’hui, nous en aurons trois de plus en mars-avril prochains, quatre de plus au printemps 2023 - soit dix appareils en tout… Puis douze, puis quinze en 2025. Ces nouveaux avions ont - et auront - pour but de desservir de nouvelles destinations - Boston, Washington et New York, je l’ai dit, et d’autres destinations par la suite, notamment au Canada. Ne pas grandir trop vite, être clair, avoir de la visibilité, être discipliné, nous en tenir à notre plan : c’est notre feuille de route.
Vous annoncez un Paris-Boston (aller simple) à 139 €. Dans une tribune publiée dans nos colonnes, Jean-Louis Barroux considère que ce vol vous coûte 22 € par heure de vol. Est-ce bien raisonnable ?
> Lire aussi : Tribune JL Baroux : un début 2022 aussi fou que la fin 2021
Il veut dire qu’à ce tarif-là nous sommes au-dessous du coût réel ? Je suis d'accord avec lui. Pourtant, bien sûr, comme toutes les compagnies, notre but est d’être profitable et donc de vendre au-delà du coût, sinon ça ne marche pas. Le pricing dans l'aérien est un mécanisme très dynamique, logique pour un marché soumis à une rude concurrence. Quand on intègre un marché avec une nouvelle offre, c’est très difficile. On a donc recours à un prix d’appel en fonction d’un yield management : plus le client réserve tôt, plus le prix est bas et c’est ce prix qui sert d’appel. Notre logique pourrait être différente. Par exemple, comme d’autres compagnies dont le remplissage des avions est capital, la baisse du prix se fait plutôt au fur et à mesure, si on a du mal à remplir. En tout cas, dans notre modèle, on peut dire que celui qui réserve le plus tardivement au prix le plus élevé, paye pour celui qui a réservé le plus précocement et bénéficié du tarif le plus bas.
Mais, en conséquence, entre le prix mis en avant et le prix qu’on paye effectivement, il peut y avoir un rapport de 1 à 3, voire plus. N’y a-t-il pas un problème de transparence, voire de tromperie ?
Je suis totalement d’accord, ça pose un problème de transparence. Je ne saurais dire pourquoi, historiquement, les prix sont annoncés de cette façon. Ce serait effectivement plus facile pour le client de savoir que le prix pour Paris-Boston est, disons, de 250 $ comme il le sait pour un produit ou un service “normal”. Et qu’il peut avoir la possibilité de payer moins mais aussi le risque de payer plus. Notre industrie n’a pas choisi cette façon de faire et c’est certainement dommage.
Mais on ne peut pas parler de tromperie non plus. Les agences gouvernementales de protection des consommateurs sont très sévères, notamment aux Etats-Unis. Si une airline fait la publicité de tarifs très attractifs, elle doit prouver qu’un certain nombre de sièges par appareil sont effectivement vendus à ce prix-là. Donc, je ne vous annoncerai jamais mon Paris-Boston à 49 € ! Et cette politique de prix bas est d’autant plus appliquée au moment du lancement d’une nouvelle route, c’est vrai. Est-ce que c’est bon pour l’industrie ? Je ne sais pas mais that’s the game.
Certains considèrent qu’à l’avenir les legacy vont se concentrer sur le long-courrier et que le court et moyen-courrier sera l’apanage des lowcosts. Qu’en pensez-vous ?
La plupart des grandes legacy - les compagnies IAG, SAS, Air France… - sont aux prises avec leur personnel souvent protégé par de puissants syndicats, et appuyé sur des accords d’entreprise anciens, sans rapport avec ce que le marché est prêt à payer aujourd’hui. Alors elles créent leurs propres lowcosts avec d’autres accords d’entreprise et elles sont effectivement en train de répartir leur activité selon le schéma que vous décrivez : le premium, les prix élevés pour le long-courrier et les prix plus bas, voire le lowcost, pour le moyen et court-courrier.
Mais vous savez, pour moi qui ai travaillé dans d'autres secteurs, je suis toujours étonné de cette distinction entre “legacy”, “airlines” et “lowcost”, comme s'il s'agissait d’animaux complètement différents. Je ne connais pas une seule compagnie qui ne s’intéresse pas aux coûts. Je suis sûr que le PDG d’Air France y pense constamment. D’une certaine façon, ils ont aussi une logique de lowcost; mais la question est : peuvent-ils être “low fair”, c'est-à-dire : peuvent-ils vraiment atteindre des coûts si bas qu’ils leur permettent d'offrir les prix bas qu’attend le marché ? Et c’est difficile pour une compagnie de plusieurs décennies, avec l’héritage de décisions prises il y a longtemps.
Et d’un autre côté, est-ce qu’on ne peut pas dire qu’une compagnie comme Easyjet, qui a environ 25 ans d’âge, est en passe de devenir une legacy ? C’est pourquoi cette distinction est, pour moi, en grande partie tronquée : il n’y a pas vraiment de nature différente entre les compagnies, mais une différence de stades de développement.
Vous remettez en cause la distinction lowcost/legacy mais d’une certaine façon, dans votre modèle, la distinction “long/moyen courrier” est également discutable. Car, en fait, votre Paris-Boston est moins un long courrier que deux moyens-courriers…
Absolument et c’est très important pour tout ce que j’ai déjà évoqué mais aussi pour d’autres raisons. Notamment, dans un vol direct Paris-Boston, il est impossible de le faire dans un avion à fuselage étroit à cause de la taille des réservoirs… Avec cette escale en Islande, au milieu de l'Atlantique, c'est possible; ce qui entraîne des coûts unitaires plus faibles et nous permet donc d’être compétitifs. Ca participe indéniablement à la solidité du business model.
Finalement, ce qui valide votre business model est dû aux contingences de la géographie : la localisation de l’Islande !
Bien sûr ! C’est l’unique raison ! Notre petit talent est seulement d’exploiter cette donnée… Tout comme Finnair profite de la localisation de la Finlande pour connecter l'Europe à l'Asie !